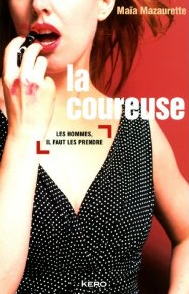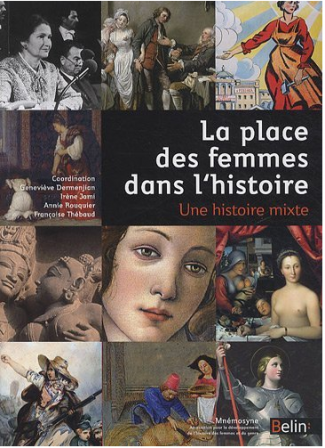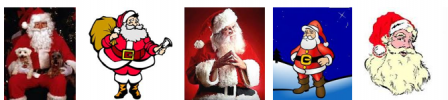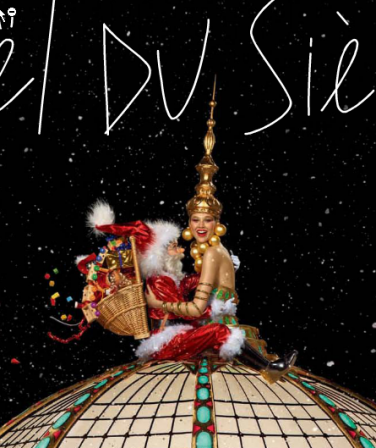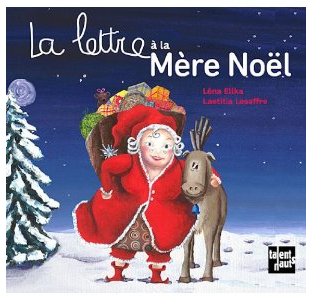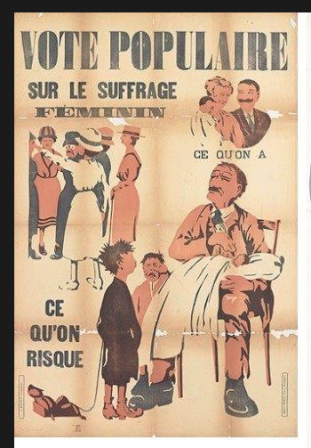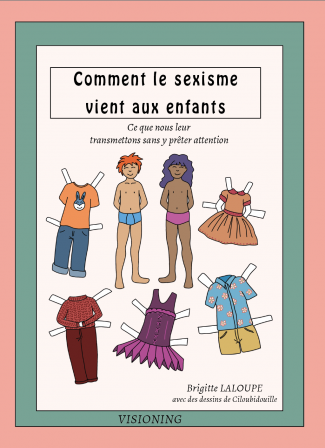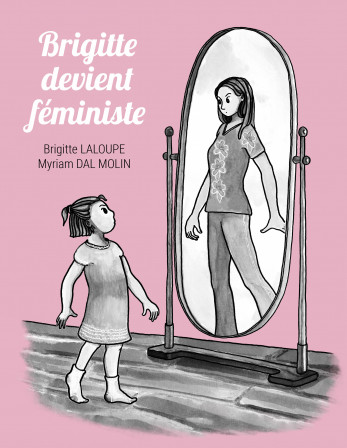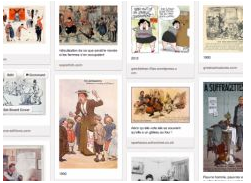Une enquête
réalisée en 2011 sur le thème "victimation et sentiment d'insécurité en
ile de France" apporte une foule d'information sur le vécu des
femmes et peut permettre d'infléchir les politiques publiques en matière
d'urbanisme.
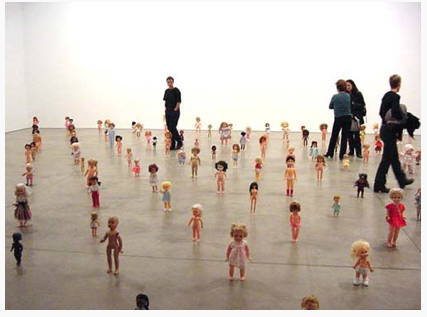
Un sentiment d’insécurité plus fort chez les femmes que chez les
hommes.
Ce n'est pas vraiment une surprise, et les différences sont énormes
- 67,1 % des enquêtées ont peur, au moins de temps en temps, dans les
transports en commun, à leur domicile ou dans leur quartier le soir, contre
34,3 % des hommes.
- 58,7 %, contre 30,7 % des hommes ont peur d’être agressées ou volées dans les
transports en commun
- 11,5 %, contre 5,7 % des hommes ont peur à leur domicile .
- 36,7 % contre 9,7 % des hommes (4 fois plus !), ont peur le soir
dans leur quartier.
Les auteures de l'article remarquent donc que le simple fait d’être une
femme nourrirait un sentiment de vulnérabilité. Or, l’idée selon laquelle les
femmes seraient "naturellement " plus vulnérables fait débat et ils se
demandent si il ne s'agirait pas plutôt d'une socialisation différente. Les
femmes font l’objet de contraintes normatives plus fortes : horaires de sortie
et lieuxà éviter, codes vestimentaires et comportementaux à adopter,etc.
La vulnérabilité qu'elles ressentent dans l’espace public est ainsi, en
partie, le fruit d’un apprentissage.
Elle découle aussi de leur expérience quotidienne. Il n’est pas rare
qu’elles y fassent l’objet de propos, d’interpellations ou encore de
comportements de la part des hommes, pouvant être assimilés à des techniques
d’approche. Or, si ces actes ne constituent pas en soi des agressions, ils
peuvent être mal vécus et faire craindre de dégénérer en violences sexuelles.
Ils agissent comme des rappels à l’ordre sexué.
Une peur qui a impact sur les déplacements
Cette peur constitue un frein à la fréquentation des espaces publics, en
particulierle soir.
D’après l’enquête, 8,0 % des Franciliennes ont trop peur d’être seules
dehors, le soir, pour sortir, contre 1,0 % des Franciliens.
Même tendance s’agissant de la fréquentation des transports en commun :
selon le mode considéré, entre 1,2 % et 3,4 % des femmes disent ne pas les
emprunter car elles redoutent trop d’y être agressées ou volées, contre 0,6 % à
1,2 % des hommes.
Résultat : les femmes sortent effectivement moins. L’enquête révèle que 52,9
% des Franciliennes interrogées ne sortent le soir pour leurs loisirs pas plus
de quelques fois dans l’année. À titre de comparaison, les hommes sont 45,1 % à
dire peu ou pas sortir.
Paradoxalement, les femmes ne semblent pas plus que les hommes privilégier
les moyens de transport personnels (voiture, scooter, moto, etc.) pour leurs
sorties. On savait
déja qu'en IDF les hommes utilisent davantage leur voiture personnelle et
ce pour tous leurs déplacements.
Les femmes ne sont pas plus victimes, mais subissent des atteintes
particulières
7,0 % des Franciliennes et 7,3 % des Franciliens interrogés déclarent avoir
été victimes d’agressions au cours des trois années précédant l’enquête, qu’il
s’agisse d’atteintes sexuelles, par des proches ou d’autres types de violences.
Les femmes ne sont donc pas plus victimes d’agressions que les hommes dans
l’espace public.
Mais si les femmes ne sont pas plus victimes de violences dans l’espace
public que les hommes, elles y subissent toutefois des atteintes différentes.
En particulier, elles sont bien plus exposées aux violences sexuelles : d’après
l’enquête, 15 % des violences déclarées par les Franciliennes dans l’espace
public sont des agressions sexuelles, contre 2 % pour les
Franciliens.
Les femmes évoquent aussi plus fréquemment des agressions sans violence
physique : 54 % disent ne pas avoir eu d’incapacité de travail d’au moins huit
jours suite au fait, ni de blessure, ni de coup, contre 43 % des
hommes.
Néanmoins, chez les femmes les répercussions des atteintes sont plus
marquées : elles estiment plus souvent que l’expérience vécue a eu des
conséquences durables sur leur comportement, sur leur santé et sur leur vie
relationnelle.
- 28 % d’entre elles évoquent des conséquences durables sur leur santé,
contre 8 % des hommes.
- 43 % d’entre elles disent n’avoir plus fait confiance aux gens
durablement, contre 21 % des hommes.
La peur ressort aussi comme étant une réaction relativement répandue chez
les femmes victimes, en touchant près d’une sur deux (48 %), contre 11 % chez
les hommes.
Comment rendre l’espace public plus sûr pour les femmes, afin qu’elles
investissent les lieux avec un sentiment de liberté et de bien-être ?
D’après l’enquête, les Franciliennes sont en proportion un peu moins
satisfaites de la propreté des rues et de l’éclairage (28,6 % contre 24,3 % des
hommes) et plus nombreuses à juger que les bandes de jeunes posent problème
(26,6 % contre 22,9 %).
Pour ce qui est de la sécurité et de la surveillance du
quartier, 43,7 % d’entre elles considèrent que la présence policière est
insuffisante, voire inexistante, contre 30,4 % des hommes.
Dans ce contexte, le lien entre sécurité et urbanisme
interroge.
Les auteures préconisent de solliciter l’expertise des femmes en organisant des
marches
exploratoires. Celles-ci sont apparues au Canada dans les années 1990.
Il s’agit d’évaluations de l’environnement urbain faites par les femmes.
Ce type d’enquêtes constitue un outil reconnu pour identifier les situations
anxiogènes.
Apparues au Canada dans les années 1990, elles apportent
une analyse de l’environnement urbain fondée sur le regard des femmes. Leur
objectif est double :d’une part, permettre aux femmes de mieux connaître leur
environnement, et donc de mieux appréhender l’espace public, d’autre part, leur
permettre d’identifier les facteurs accentuant les risques d’agression et leur
sentiment d’insécurité, et ainsi apporter aux acteurs ayant en charge la
conception urbaine des réflexions sur la mise en place d’aménagements plus sûrs
et sécurisants.
Photo

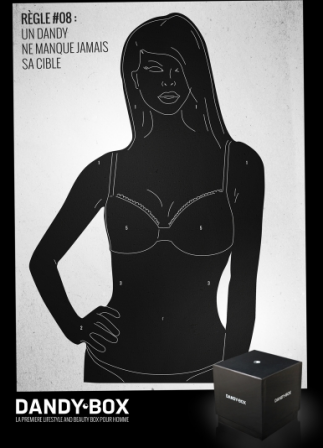
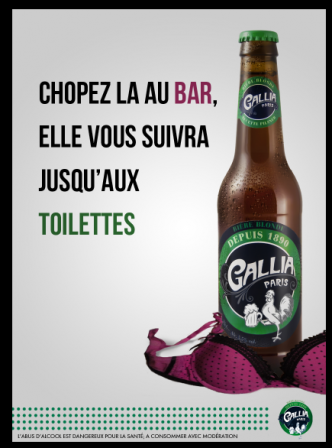

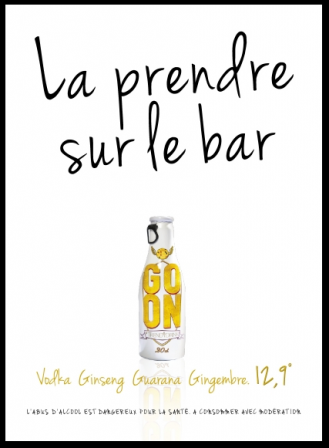
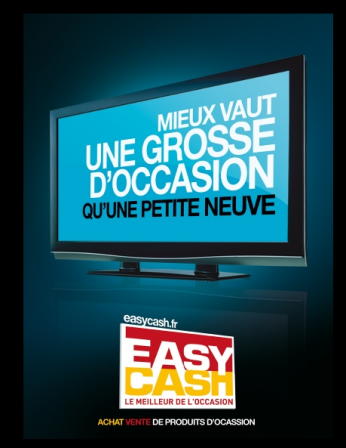
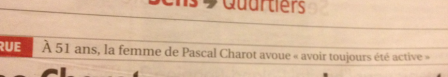
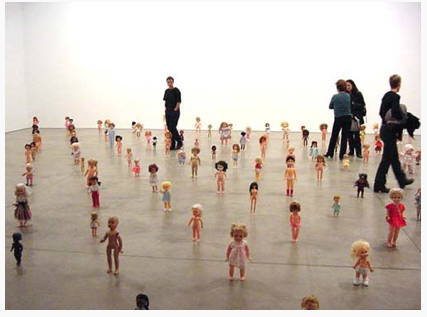




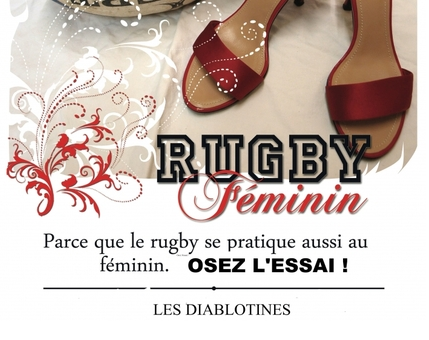

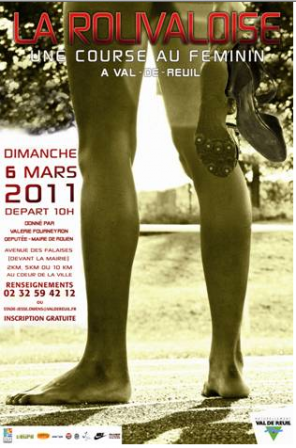
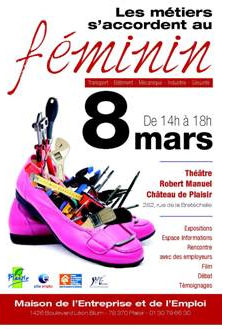
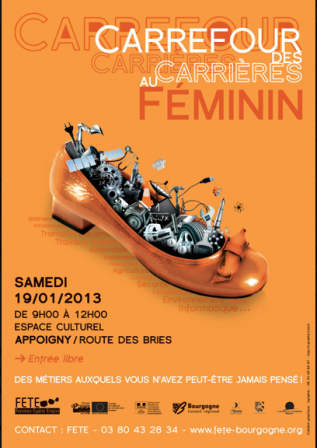
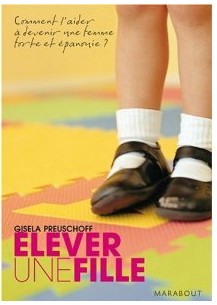
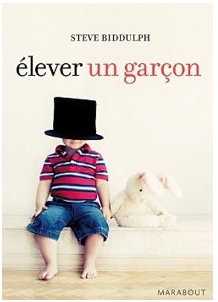
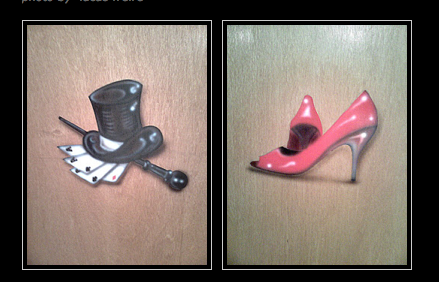
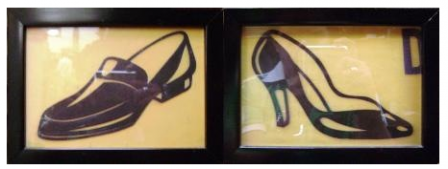

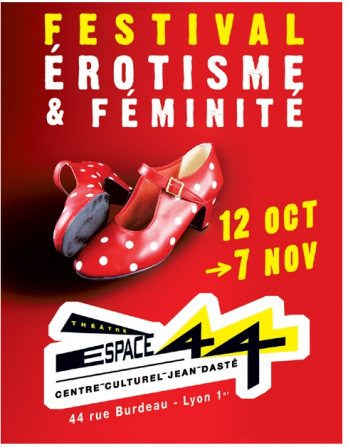

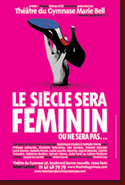

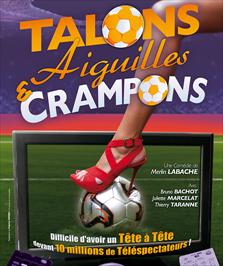
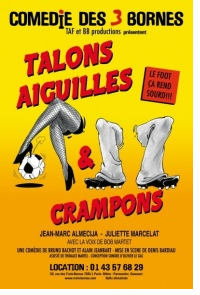
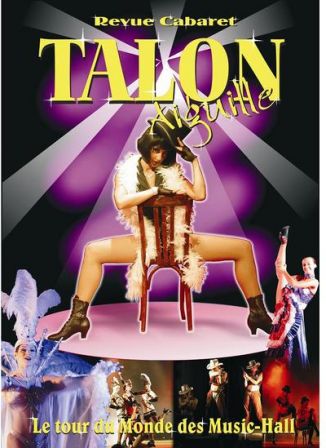
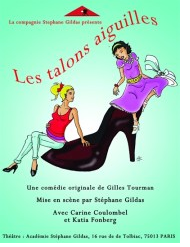
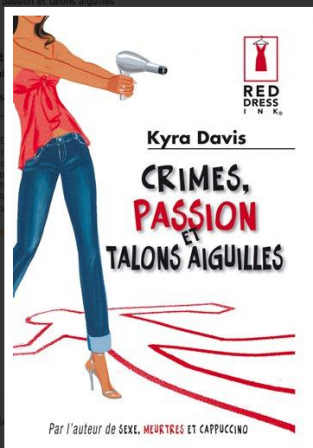
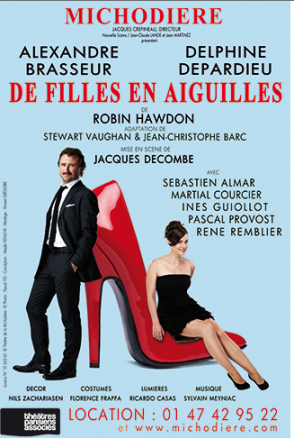
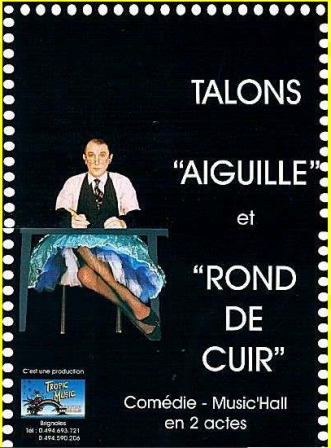



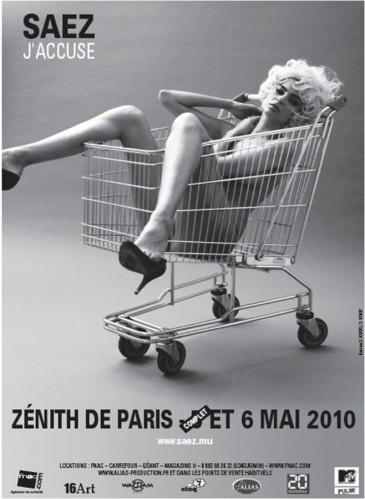
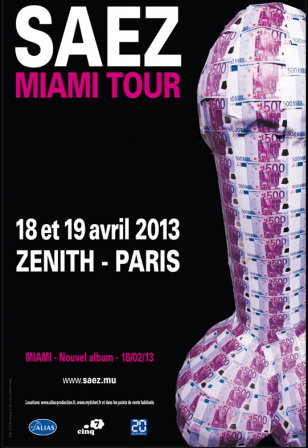

 2013 année de l'égalité à l'école ?
2013 année de l'égalité à l'école ?